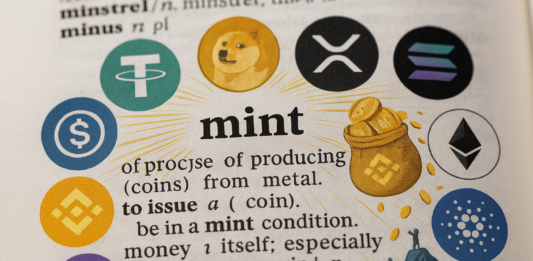L’écosystème crypto abonde de plateformes d’échange en tous genres. Mais il y a exchange et exchange. Les centralisés, à l’instar de Binance, et les décentralisés, comme Uniswap. Ce sont ces derniers qu’on nomme DEX. On vous explique.
Depuis l’apparition du bitcoin et l’émergence globale des cryptomonnaies, diverses places de marché numériques se sont progressivement structurées pour encadrer la rencontre entre acheteurs et vendeurs d’actifs numériques. Les plateformes de trading crypto, les fameux exchanges, permettent ainsi à quiconque, de l’investisseur particulier aux pros du courtage, d’échanger du bitcoin contre du dollar, de l’ether contre du tether… À l’heure d’écrire ces lignes, selon les données du site de référence CoinMarketCap, on dénombre à l’échelle mondiale quelque 670 de ces « bourses crypto ».
En termes de flux financiers, depuis le début de l’année, ces plateformes ont canalisé chaque mois l’équivalent de 600 milliards $ de transactions en moyenne. Une valeur impressionnante mais nettement inférieure par rapport aux sommets de 2021 et encore éclipsée par celle échangée sur les marchés d’actions traditionnels. Les bourses européennes et américaines par exemple brassent ensemble plusieurs milliers de milliards. Sans omettre au passage le fait que des études aient déjà alerté sur le caractère fictionnel ou artificiellement gonflés des chiffres renseignés par une grande majorité des plateformes d’échange de crypto-actifs.
Investir en direct sur la blockchain
Suivant les principes fondateurs de la finance décentralisée (DeFi) permise par les technologies blockchain et cryptographiques, à savoir la désintermédiation des services, l’accessibilité universelle sans permission et l’absence d’une autorité centrale, certaines de ces plateformes crypto sont donc des DEX. Des plateformes de négociation de gré à gré reposant sur divers blockchains et des smart contracts.
Pas d’entité centrale gérant les opérations de la plateforme, des participants qui contrôlent directement leurs actifs numériques, l’exécution des transactions réalisée sur la blockchain, règlement et inventaire compris, voilà ce qu’offrent en synthèse les Uniswap, Bancor, Dydx et autres centaines de DEX existant.
Ce degré de liberté représente un défi technique puisqu’aucun organe central ne contrôle les mouvements de fonds, les accès au réseau, les processus de trading ou encore la validation des transactions. C’est là qu’interviennent des « faiseurs de marchés », des protocoles essentiels nommés Automated Market Makers (AMM) qui apportent les liquidités nécessaires à la formation des prix entre participants. On fera l’économie ici des formules mathématiques employées pour déterminer les prix, le fonctionnement des smart contracts, les calculs de frais et les mécanismes de pools de liquidités intervenant dans les échanges de tokens et autres actifs numériques. Mais les AMM jouent un rôle central… dans la décentralisation des transactions.
Un portefeuille géré personnellement
Avant de trader ses cryptos sur les plateformes, un utilisateur doit évidemment les stocker quelque part, dans l’équivalent blockchain d’un portefeuille, un wallet (ou techniquement une adresse blockchain) dont l’entrée et la sortie sont protégées par des clés cryptographiques, privées et publiques. Et en fonction de qui conserve les clés privées, les wallets peuvent être qualifiés d’hébergés (on dit aussi hosted ou custodial), la garde étant assurée par la plateforme, ou d’auto-hébergés (self-hosted ou non-custodial), la garde étant assurée individuellement par le détenteur des crypto-actifs. Le propriétaire de ce dernier wallet peut ainsi effectuer des transactions directement, sans intermédiaire. Cette faculté a d’ailleurs forgé un véritable mantra dans l’écosystème du bitcoin, le célèbre adage « not your keys, not your coins ». Le chaos engendré l’année passée par la débâcle de la plateforme centralisée FTX a au moins eu ce mérite de sensibiliser les foules sur le sujet.
D’ailleurs, en général, un self-hosted wallet est requis pour participer à un DEX. L’utilisation demande un certain apprentissage, et de la rigueur en termes de gestion, déjà pour ne pas perdre ses clés, mais aussi s’exposer le moins possible aux techniques de hack et d’arnaques toujours plus inventives.
Présenté plus trivialement, cela revient à mettre ses billets de banque à l’abri sous le matelas, aime-t-on illustrer à la World Federation of Exchanges, le regroupement industriel des places de marché classiques. On peut conserver l’argent et en user librement. Et advienne que pourra en termes de sécurité. Peu probable, à l’heure actuelle, que les particuliers bénéficient d’une protection équivalente à celle des institutions de confiance de la finance traditionnelle.
Des enjeux réglementaires
En septembre dernier, les volumes de transactions sur les DEX ont accusé leur sixième baisse mensuelle consécutive, retombant à leur plus bas niveau depuis janvier 2021 à hauteur de 44,28 milliards de dollars, selon les chiffres consolidés par le site spécialisé DefiLlama.
L’activité de ces crypto-bourses décentralisées avait pourtant bénéficié d’un soutien externe, à savoir le renforcement de la surveillance réglementaire sur les CEX, les plus grands acteurs tels que Kraken, Bittrex, Coinbase et Binance se retrouvant tantôt dans le collimateur des régulateurs, tantôt carrément devant les tribunaux.
Mais compte tenu de la conjoncture, des conditions de marché et du durcissement des relations avec les autorités, les faiblesses des DEX ont commencé à leur jouer de mauvais tours. À l’instar de l’absence d’une entité juridique ou d’une personne clairement définie derrière le réseau décentralisé et ses protocoles. Le fait que les participants échangent directement sur la blockchain, pour leur compte propre et sans intermédiation, posent question sur le plan de la conformité, de l’indentification bancaire (KYC) ou des mesures anti-blanchiment (AML).
Une opacité et un anonymat sur lequel s’est déjà penché le Groupe intergouvernemental d’action financière (GAFI), indiquant que si les logiciels supportant les DEX ne constituaient pas des prestataires de services crypto au sens strict, les développeurs, propriétaires et opérateurs pourraient être tenus responsables.
À noter, par ailleurs, que l’avant-gardiste réglementation mise en place en Europe pour harmoniser les standards des marchés des actifs numériques, MiCA, ne couvre pas (encore) les services crypto fournis de manière entièrement décentralisée. Autrement dit, les DEX.